
Jihadisme : l’Afrique face à une vague meurtrière, chiffres alarmants, foyers de violence. Voici comment comprendre et appréhender le terrorisme en Afrique.
Le contexte actuel
Les données récentes mettent en évidence une aggravation rapide et durable de la violence jihadiste en Afrique, avec une concentration particulièrement élevée dans le Sahel. Selon les estimations issues de centres de recherche spécialisés, le nombre de décès attribués à des groupes armés islamistes y a été multiplié par près de dix depuis 2019. Cette région, qui s’étend de la Mauritanie au Tchad en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est devenue l’épicentre mondial du terrorisme. En 2023, elle a représenté plus de la moitié des morts liées au terrorisme dans le monde, soit environ 3 885 décès sur un total estimé à 7 555.
Cette hausse traduit plusieurs phénomènes concomitants. D’une part, l’extension territoriale des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, qui imposent leur présence dans des zones rurales stratégiques, loin du contrôle étatique. D’autre part, l’affaiblissement des appareils sécuritaires nationaux, fragilisés par des coups d’État successifs, des retraits de forces étrangères et des ressources limitées. Ce contexte permet aux insurgés de renforcer leurs positions et d’intensifier leurs offensives, souvent coordonnées et ciblant à la fois les forces armées et les populations civiles.
Les répercussions dépassent la seule dimension sécuritaire. L’insécurité chronique paralyse l’économie locale, perturbe les circuits commerciaux et provoque des déplacements massifs de populations, accentuant la crise humanitaire. Le Sahel, déjà confronté à des tensions climatiques et alimentaires, se trouve ainsi dans une spirale où la fragilité institutionnelle alimente la progression du jihadisme, et inversement. Cette dynamique, désormais structurelle, laisse présager une poursuite de la dégradation si aucune réponse coordonnée, locale et internationale, n’est mise en œuvre rapidement.
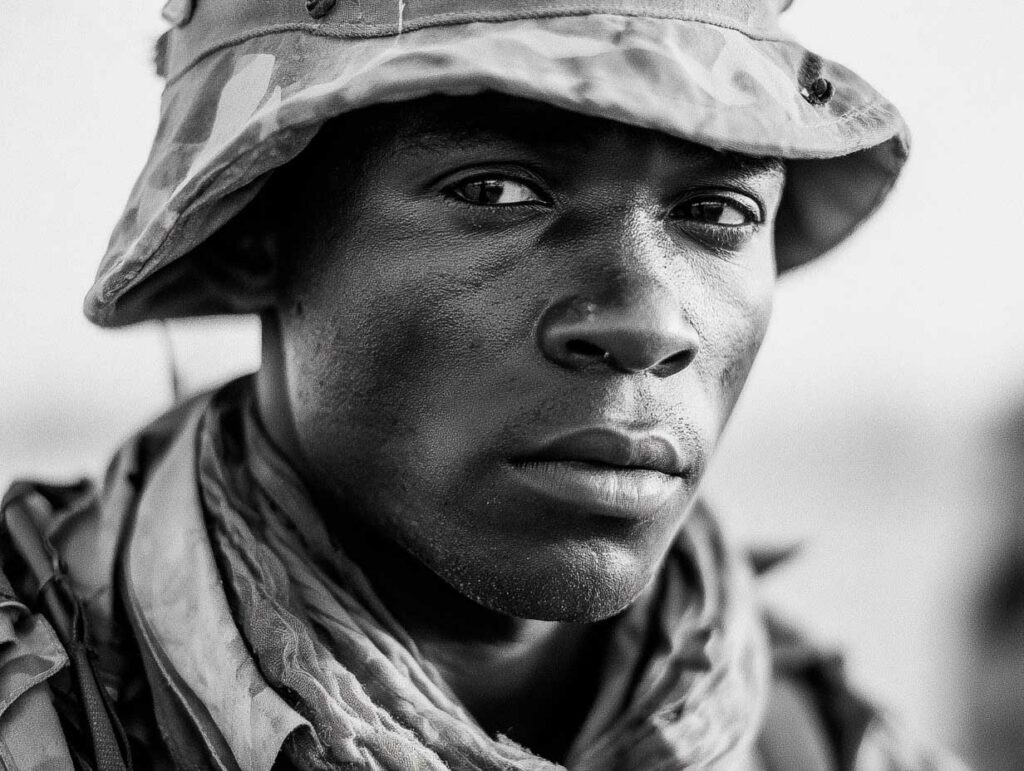
Ce qui agit comme moteur de cette violence
Plusieurs facteurs interconnectés expliquent l’expansion rapide et la persistance de la violence jihadiste en Afrique, particulièrement au Sahel.
1. Fragilité des États et retrait des soutiens occidentaux
La région connaît une succession de coups d’État qui affaiblissent durablement les institutions. Les gouvernements militaires qui ont remplacé les régimes civils, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, privilégient de nouvelles alliances, notamment avec des sociétés paramilitaires russes comme le groupe Wagner ou Africa Corps. Parallèlement, le départ progressif des forces françaises et européennes a créé un vide sécuritaire. Ce retrait laisse aux groupes armés une marge de manœuvre accrue pour occuper des zones stratégiques et contrôler les axes commerciaux.
2. Prolifération et coordination accrue des factions jihadistes
Les principales organisations en présence – JNIM affilié à Al-Qaïda, État islamique dans le Grand Sahara (IS-GS), État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), Boko Haram, ou encore al-Shabaab – ne se contentent plus d’opérer localement. Elles coordonnent désormais leurs actions, échangent du renseignement, des armes et des combattants, ce qui renforce leur efficacité militaire. Certaines étendent leurs opérations vers les pays côtiers, élargissant ainsi la menace.
3. Pression socio-économique et motivations pragmatiques
Selon des études menées par l’ONU, 92 % des recrues rejoignent ces groupes avant tout pour des raisons économiques : absence d’emplois, manque de services publics, accès restreint aux ressources. L’idéologie religieuse joue un rôle secondaire. Ce profil de recrutement traduit un enracinement du jihadisme dans les réalités quotidiennes, où les groupes armés se positionnent comme des employeurs et des protecteurs, profitant de l’effondrement de la gouvernance locale.
Données factuelles clés
Les chiffres disponibles permettent de mesurer avec précision l’ampleur de la menace jihadiste en Afrique, en particulier dans la région sahélienne.
En 2023, le Sahel a enregistré environ 3 885 décès attribués à des actions terroristes, soit plus de 50 % du total mondial. Ce volume place la région au premier rang des zones les plus meurtries par la violence islamiste armée. Ce constat est d’autant plus préoccupant qu’il s’inscrit dans une dynamique de croissance continue.
Depuis 2019, le nombre de victimes dans cette zone a été multiplié par près de dix. Cette accélération résulte de la combinaison entre expansion territoriale des groupes jihadistes, affaiblissement des États, et repli des forces internationales. Les foyers d’insécurité se sont étendus au-delà des zones historiquement touchées, atteignant des régions jusque-là relativement stables, notamment au sud du Mali, au nord du Bénin et du Togo, ainsi qu’aux frontières de la Côte d’Ivoire et du Ghana.
L’Afrique subsaharienne concentre désormais une part majeure de la mortalité mondiale liée au terrorisme. Les enquêtes de terrain montrent que 92 % des nouvelles recrues rejoignent ces organisations pour des raisons d’ordre matériel : promesse de rémunération, accès aux ressources, protection ou intégration à des réseaux économiques parallèles. Ces motivations illustrent la nature pragmatique du recrutement, où l’idéologie n’intervient que secondairement.
Ces données confirment que le jihadisme africain n’est pas seulement un phénomène militaire ou religieux : il s’ancre dans un environnement socio-économique dégradé, qui constitue un terreau idéal pour sa propagation rapide et durable.

Conséquences concrètes
L’essor et la persistance des violences jihadistes en Afrique ont des répercussions directes, à la fois sur les populations locales, les équilibres régionaux et la sécurité internationale.
Déplacement massif de population
L’insécurité chronique provoque des mouvements forcés à grande échelle. Des millions de personnes sont contraintes de quitter leurs villages pour chercher refuge dans des zones plus sûres, souvent surpeuplées et mal équipées pour les accueillir. Les camps de déplacés se multiplient, entraînant des tensions supplémentaires sur les ressources en eau, nourriture et soins. Cette pression humanitaire s’ajoute aux effets du changement climatique, qui réduit la disponibilité des terres arables et accentue les rivalités communautaires. En parallèle, l’exode vers l’Afrique du Nord et l’Europe s’intensifie, alimentant les flux migratoires mixtes et posant de nouveaux défis aux pays de transit et de destination.
Effet domino géopolitique
Le désengagement progressif des forces occidentales dans plusieurs théâtres africains a laissé un vide stratégique que comblent d’autres acteurs, en particulier la Russie via ses structures paramilitaires Wagner et Africa Corps. Ces forces offrent un soutien militaire aux régimes en place, mais souvent au prix d’exactions contre les civils et d’une dépendance accrue aux intérêts de Moscou. Cette évolution ne se limite pas à un simple changement d’alliances : elle modifie les rapports de force régionaux, fragilise les dispositifs multinationaux de lutte antiterroriste et crée des zones grises échappant à tout contrôle institutionnel. À terme, cette recomposition géopolitique accroît le risque que l’Afrique serve de base logistique et opérationnelle à des menaces visant directement les intérêts occidentaux et la stabilité mondiale.
Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.